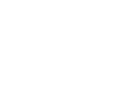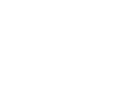Sa nomination, obligatoire depuis le 1er janvier 2019, peut faire bouger les lignes.
Depuis le 1″ janvier 2019, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel impose à tous les comités sociaux et économiques (CSE) de nommer parmi leurs membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. La mesure s’inscrit dans le prolongement de la loi Rebsamen (2015) et de la loi travail (2016), qui ont intégré la notion de propos sexiste, et renforcé les obligations de l’employeur en matière de prévention contre le harcèlement sexuel.
Elle a été globalement saluée par les syndicats et les associations féministes, avec quelques réserves concernant l’insuffisance de moyens dont bénéficient ces référents – et surtout, les risques pesant sur leur indépendance. Les entreprises d’au moins 250 salariés doivent aussi désigner un second référent « chargé d’orienter, d’Informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes », précise le texte de loi.
Un an après l’entrée en vigueur de la mesure, les entreprises se sont-elles pliées à cette obligation? Difficile à dire: « Le ministère du travail ne dispose pas d ‘outil informatique nous permettant de connaitre dans quelle mesure [les CSE] le font réellement », nous indique le ministère. Quant aux référents désignés par l’employeur dans les entreprises de plus de 250 salariés, il n’existe aucun moyen de les recenser. Mais Karine Armani, fondatrice d’Equilibres, une société qui œuvre pour l’égalité au travail, considéré que cette obligation est prise au sérieux: « Le mouvement #metoo, qui a mis en lumière le problème du harcèlement sexuel, a contribué à faire exister le sujet au sein des entreprises ».
Un texte de loi imprécis
D’autant que les cas portés devant la justice semblent en augmentation. Me Alain Antoine, du cabinet du même nom, ainsi que Me Guillaume Boulain, de CRTD & Associés, membres du réseau Eurojuris, témoignent tous deux d’une « hausse » des affaires de harcèlement sexuel. « A ce jour, le nombre de contentieux sur cette thématique reste stable, mais nous constatons une libération de la parole en entreprise », affirme de son côté Me Céline Vieu Del Bove, du cabinet Aguera Avocats.
Dirigeante de la société B2B consulting RH et ancienne DRH chez Thales, Béatrice Bretegnier a sondé des grandes entreprises de la région PACA, ou elle exerce. « Fin décembre, quinze des dix-huit entreprises interrogées avaient déjà nommé leur référent CSE et leur référent employeur; pour les autres, qui ont constitué tardivement leur CSE, c’était en cours » rapporte-t-elle. Rappelons que les CSE devaient être constitués avant le 31 décembre 2019.
Sur la forme, l’obligation de nommer un référent semble donc avoir été respectée. Mais sur le fond, de quels pouvoirs disposent ces nouveaux interlocuteurs? « L’implication des entreprises en matière de lutte contre le harcèlement est très variable: il me semble que la moitié nomme un référent uniquement pour respecter la loi », considéré Béatrice Bretegnier. En Clair, sans réfléchir à ses attributions.
Le texte de loi est imprécis sur le rôle du référent. A qui rapporter les cas signalés? Comment se partagent les tâches entre le référent CSE et le référent employeur? Rien n’est dit non plus concernant les moyens mis à leur disposition: «Le référent désigné par le CSE n’a pas d’heures de délégation, regrette Marie Becker, directrice conseil au sein du cabinet Accordia, qui a également siégé au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP). II n‘y a pas non plus d’obligation d’enquête. » Le CSE a néanmoins le devoir d’exercer son droit d’alerte en cas d’atteinte au droit ou à la sécurité des salariés.
Aux yeux de Karine Armani, la nomination d’un référent a d’abord le mérite de faire effet de levier dans l’entreprise: « Cela permet d‘ouvrir une réflexion globale sur ce qui est mis en place en matière de process de détection, de formation, de lutte contre le sexisme… »
En la matière, les moyens mobilisés par les petites et les grandes entreprises ne sont pas comparables: « dans les plus petites boites, les référents sont parfois livrés à eux-mêmes », s’inquiète Marie Becker.
Recueillir la parole des victimes n’est pas non plus chose aisée:« Il est difficile de rester neutre, hors des stéréotypes que l’on a tous, par exemple face à une femme que l’on juge très décolletée », prévient Béatrice Bretegnier. Les récits des potentielles victimes peuvent aussi affecter les référents: « Lors d’une de mes formations, la référente d’un CSE a pleuré à l’occasion d’un jeu de rôle où elle devait accueillir une salariée harcelée », relate la dirigeante de B2B consulting RH.
Trois ans de prison
Du côté des victimes, la présence de cet interlocuteur dans l’entreprise peut-elle aider à libérer la parole? Karine Armani y croit: « Il s’agit d’un sas, qui permet au collaborateur de s’exprimer sur sa situation. » Encore faut-il que la confiance soit là. Béatrice Bretegnier s’interroge sur leur profil: « je vois souvent des référents nommés au niveau des ressources humaines, constate-t-elle. Or, il peut être compliqué pour une victime d’aller voir quelqu’un des RH. Lorsqu’ils sont assimilés à la direction. »
D’autant que la tentation d’enterrer l’affaire peut être grande. Marie Becker cite le cas d’une référente qui s‘est heurtée au veto du service juridique de son entreprise lorsqu’elle a voulu consulter des anciens dossiers. Mais la directrice conseil du cabinet Accordia estime que la mise en place de deux référents dans les grandes entreprises sert de bouclier contre les éventuelles pressions: « Si l’employeur est récalcitrant ou que le délégué syndical est lui-même un harceleur, une enquête conduite conjointement offre plus de garanties. »
Malgré ces réserves, Marie Becker reste optimiste: « Compte tenu du contexte sociétal, il n’est plus possible aujourd’hui d’enterrer les dossiers. » Pour rappel, l’auteur de faits de harcèlement sexuel au travail encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
LE MONDE , jeudi 23 janvier 2020